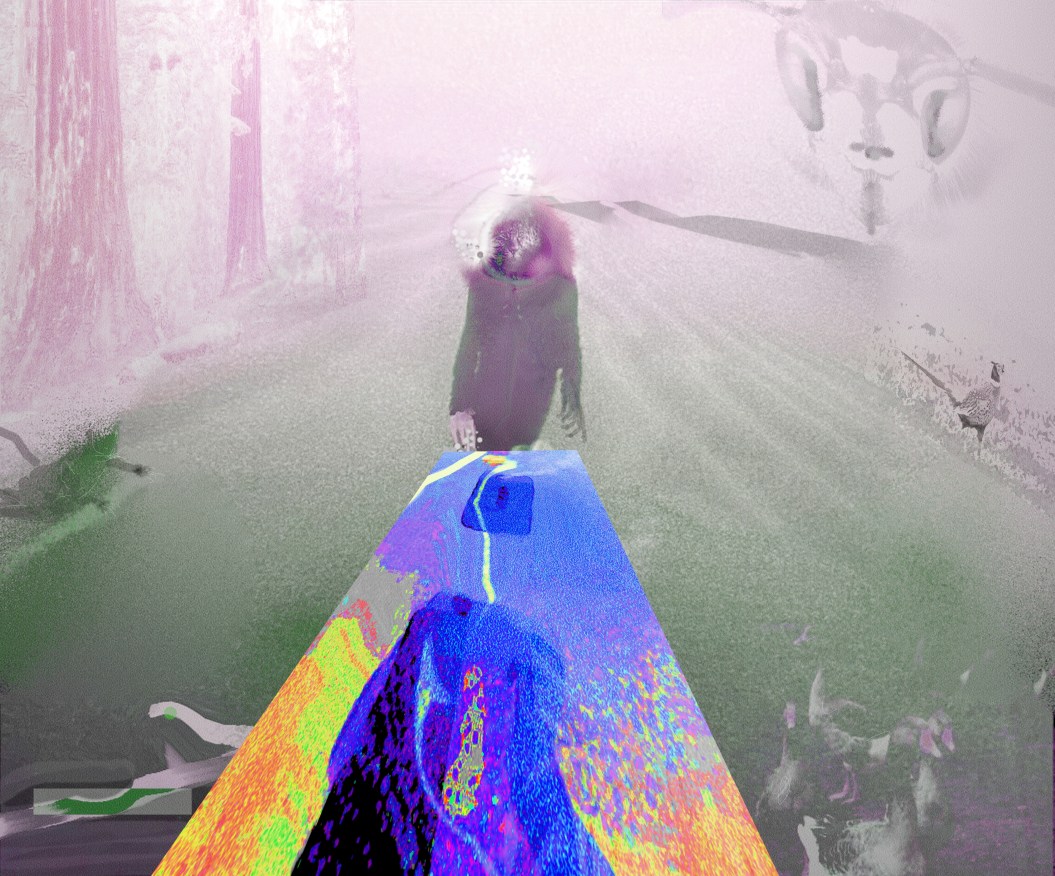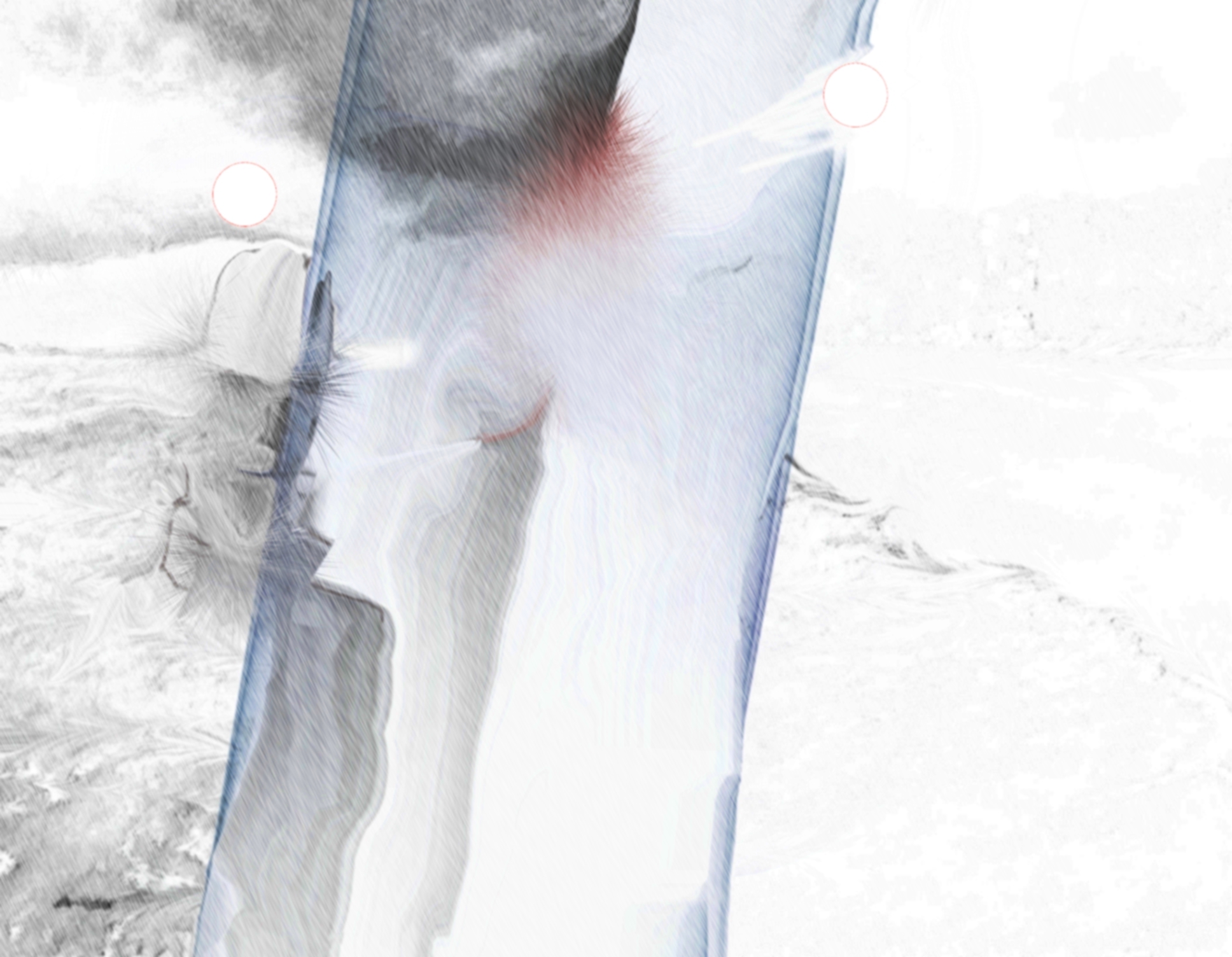Les Jours du Jaguar – A song
Une chanson brutalement traduite en anglais pour un ami tibétain qui, malgré une bonne connaissance de la langue française, se retrouve au milieu de la route, égaré au moment de choisir la vraie voie à un carrefour où des brins de signification, tels des traits de lumière d’éclairs pincés par des pierres qui les enserrent à l’état de gisants, ne s’agitent plus dans le vent, ne lui diffusent plus aucune prière. Un bout de piste détachée du continent passe comme un avion au ras du torrent, un gué s’enroule autour de lui-même et s’enfonce dans les rugissants.
Tout espoir géographe semble en quarantaine.
Souvent l’indécelable signe d’une entrée en terrain boueux, biotope d’élection du commentaire, dont les raclements de gorges et de ravins sont la négation actée de la géologie du subtil déplacement du sens. Difficile de gagner le refuge de la compréhension neutre, de repérer au loin le pavillon du déchiffrement standard, qui d’abord comprend quoi, même au cœur de la communauté des sages, qu’est-on seulement dans l’obligation de comprendre nous-mêmes en premier lieu si l’auteur se perd de vue lui aussi dans le souffle de l’empire des miettes de son satellite mental éclaté ? Vorsokratiker en diable, fataliste de Dieu. Qui est ce Murat aux mille morceaux dont tout le monde parle, fait-il pour de vrai et selon son bon plaisir le jaguar à ses heures olmèques ou mayanes perdues ?
Son yaguarété a-t-il quelque chose à voir avec le Lynx français qu’il chanta plus tard, ou avec l’once de Dante, en savant lecteur du divin coureur des collines toscanes qu’il fut ? Est-ce son aérolithe noir, autogame, fertile de lui-même, l’anti-prédateur des petits chemins séculiers sans direction temporelle, bras nus avec des traces de perfusion d’une horloge sans maître, ou son minéral félin en terre étranglée par le calendrier grégorien d’une unité de temps dont la route de la soie étouffe une face écharpée, dissimule dans les sillons de ses traits les dernières épices d’un pays par de mauvais vers razzié ? Sa « Lonza del vasto », à lui, homme-jaguar, guerrier des guerriers ultime, la bouche d’ombre toujours ouverte en grand, dans la plus terrible des manifestations discrètes — que trahit tout avalement d’une pensée — lorsqu’elle épelle le sens d’un mot, dans la friction de ses sons charnus, pour tout neuf le recracher sur le ventre de la langue. Les attitudes splendidement humaines prêtent aujourd’hui le flanc à beaucoup d’imitations.
Qu’il vaudrait mieux crever ?, hésite le jaguar. Un El Tigro qui fait peur à la peur, qui surprend les ténèbres de l’époque dans leurs habits du dimanche, avant qu’elles ne s’effeuillent dans un strip obscène. Comme il nous le révèle à la fin, la chanson serait un message dans une bouteille, une lettre à la mer, une correspondance au creuset des choses avouables lorsqu’on sacrifie au culte de l’amitié, l’écrit cruel d’un homme-panthère encore carnivore pour quelques maigres repas, comme le sont férocement aussi certaines jaguars au féminin, qui s’extrait de l’art poétique habituel, fluide musical devenu acide par la pression de questions fortuites, style empreint de ska, qui s’exfiltre de son carcan dans des passes verbales secrètes, entre les couches d’un milieu poreux et fissuré. D’une patte étonnée par ce vaguage, il touche le corps de l’Amour allongé sur le cadavre d’un sérac rouge comme linge.
Trempe et brassage des idées ne sont plus ce qu’ils étaient, ne pas comprendre est un luxe des lendemains d’un jadis mort à la place passager d’une chaste ébriété, trop fermentées les bonnes questions bondissent hors de la cuve et lui sautent à la la gueule. À force coups d’incendies, qui répondirent avec grâce à chacun de leur mandement cardinal, la lumière se défricha une clairière sous la peau du jaguar, feu et obscurité y refirent en paix du derme.
Love is gone or not gone, that’s the pending statement.
Le charbon monosperme couvait ses braises comme des fruits. Les triomphes de l’amour fixent les contours des tourments, en découpent de la carte les sentiers du vain désespoir, étrangement.
Il connut de beaux passages, l’homme-panthère n’eut jamais de misère avec la femme.
Le poison du cobra venait de bon cœur se livrer prisonnier, crocs soudoyés au bord de la tige de verre d’un réséda invisible dans la glace de tous les désirs communs aux eaux vulnéraires. « Le visage lisse des bonnes questions est cousu d’innommables estafilades, une bougie sous le menton, imparables repères du méridien de Chester dans l’espace. Elles se méfient de nous, les chanteurs. » Chante le jaguar.
De son message barbare, inexorable, qui ne s’en laisse pas dicter, ni par les évènements ni par leurs cendres volatiles qui les transforment en rumeurs. Une chanson tombée de nulle part, composée dans l’urgence, une musique dont le tract redit le cours pourtant extraordinaire de la chronique des Hommes vouée à la voracité des nouveaux embrasements d’un temps qui les tasse, sitôt apparus, à coup de pelle de sa mémoire épisodique, en fuite dès la première étincelle auditive. Vers nous s’abîment les papillotes.
Seraient-ce des boucles hassidiques de Breslov, celles des jeunes d’origine yéménite, le souvenir d’échanges avec sa voix intérieure, l’écho d’un reportage à la télé, ou l’histoire plus prosaïque de bonbons au chocolat, spécialités des pâtisseries lyonnaises clandestines, dont les papiers d’emballage regorgent de formules sucrées, de prières sèches comme l’orge battu, qui frémissent au vent tels des bouts de tissus accrochés aux pierres des cols des montagnes au-dessus des lacs du nord du Tibet, à l’image fidèle de biscuits d’anniversaire que sait fabriquer l’Angleterre ?
On ne le saura jamais, même si avec le jaguar il ne faut jamais dire peut-être. Les cours des rivières et des fleuves de légende ont leur propre fumée qui lutte contre l’extraction de ses futurs remous faiseurs de ciels.
Des ocelles de brume marquent le pelage du vent, glissée sous elle, la fumée se mue en autant d’îles aux sables invisibles dont le jaguar a soudain plein les dents, des taches de doigts d’une tempête qu’il porte, vivant sablier empli de grès, comme il porterait ses petits, saisis par la peau du flux. Un jaguar reste calme devant les visions des vives embouchures aux terminus plats mais profonds comme la trace de l’empreinte dentaire d’un vieux glacier, calme sous leurs morsures, habilement recède, même s’il peut rencontrer l’effroi et le recevoir, miroir retourné vers sa source, il le dompte. Une peur vaincue qui neutralise puis ausculte nos petits abysses contemporains sévèrement carbonés, et qui leur intime de garder pour eux le syndrome d’un Mal édulcoré à l’acide aspartique avant qu’ils ne le livrent à leur habituel numéro de dénudement, trop actif pour être honnête lorsqu’il rhabille en vérité la réalité crue. La GPA argentifère, la manipulation des plus pauvres d’entre nous, l’évaporation d’un lien immémorial qui semblait unir les humains, un autrui qui ne brille plus que sous le soleil du patient, malade de la perpétuelle attente d’un soi-même qui ne vient pas, tel est le grognement de l’élémentaire actualité qui s’accroche aux thèmes écrémés par sa chanson. Une chanson qui emprisonnerait, par sa sauvagerie, les éléments d’une digression personnelle, une tentation dont elle nous met à l’abri, à l’inverse des commentaires sur une œuvre, les miens en tête, j’en ai la pure conscience. Le jaguar de Murat en a après sa propre chair.
Il offre un sacrifice non sanglant, de l’ordre du rêve, comme endormi on se scarifie la peau sous le chant des promesses du sommeil paradoxal, train de l’eau sorti, griffes des flots rentrées, comme une Seine charrie ses émotions mortes flottant sur le dos jusqu’à Cabourg, via Honfleur, le Baudelaire bon nageur n’est jamais loin. Il y a des rugissements qui ne se perdent plus, dont revient le cours.
Auprès du duvet des oies vivantes de la doublure de notre Moi, que l’on garde brûlantes comme de nouveaux-nés en-soi.
*
Publié sur Flickr en août 2023.